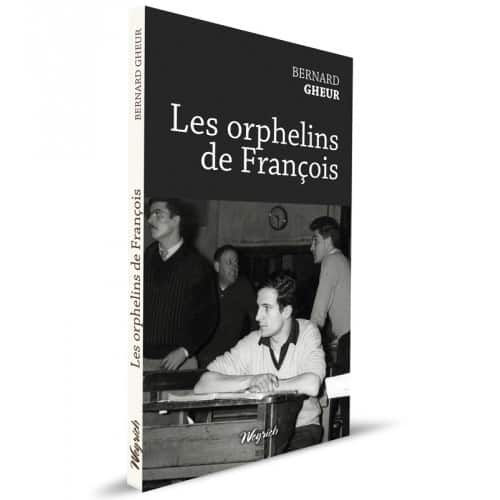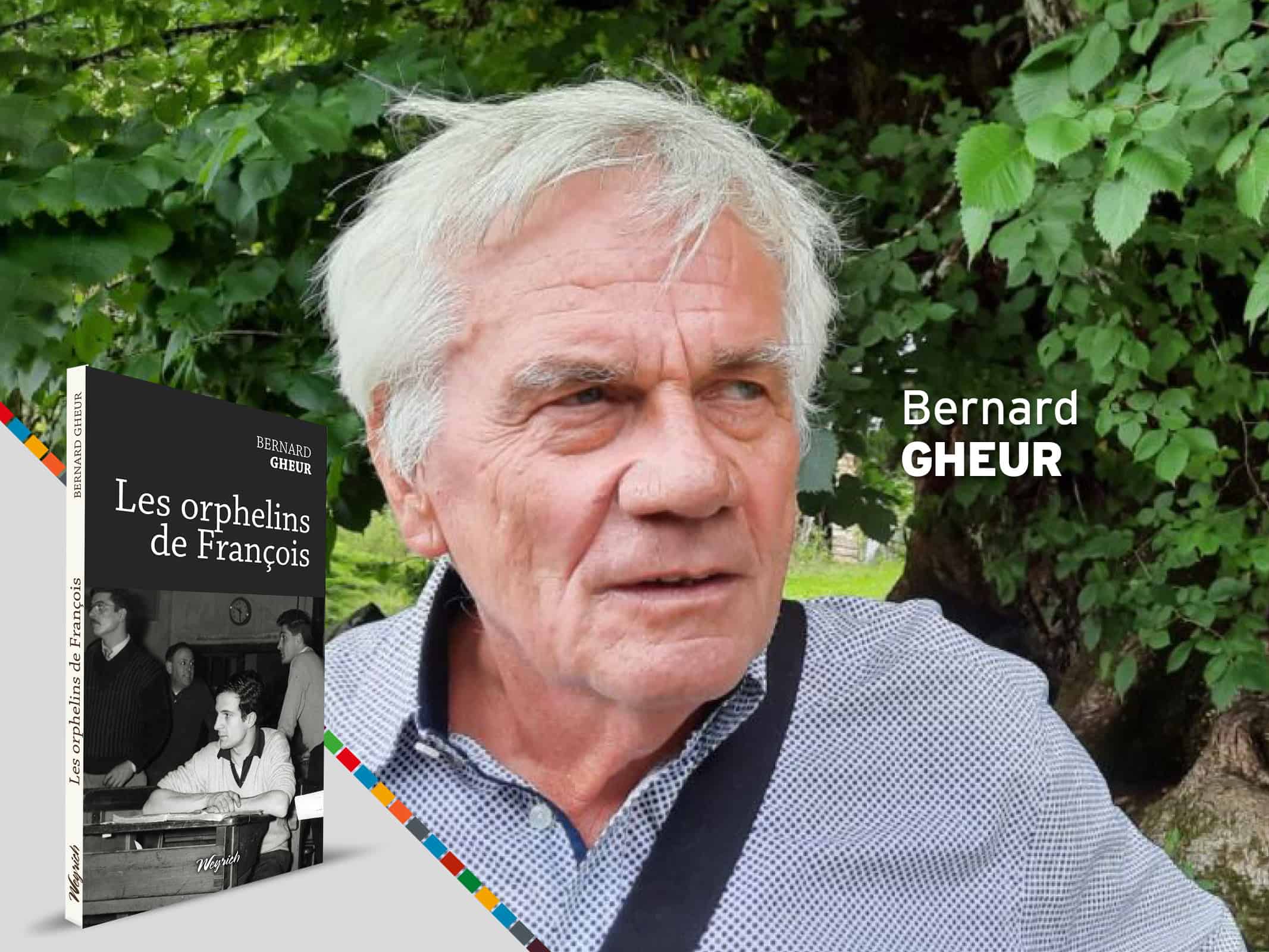Des émois de l’adolescence aux souvenirs de la Deuxième guerre mondiale
Un article signé René Begon pour le Carnet et les Instants.
Chez Bernard Gheur, la nostalgie est un peu comme une seconde nature. L’essentiel de son œuvre réussit la gageure d’être à la fois ancré dans le quotidien liégeois qui lui est cher, mais aussi de tracer un portait très juste de la jeunesse des années soixante, celle qui, un peu plus tard, communiera à Woodstock ou sera sur les barricades à Paris. De ce point de vue, on peut soutenir que Bernard Gheur a eu des intuitions très subtiles de ce qui évoluait dans l’esprit de la jeunesse, et dans le sien en particulier, dans les années cinquante et soixante : l’opposition au monde adulte dans Le testament d’un cancre, la passion du cinéma dans La scène du baiser, La bande originale ou Nous irons nous aimer dans les grands cinémas, la fascination, déjà, pour la Résistance et la période de la Libération dans Le lieutenant souriant. D’une certaine façon, on serait tenté de considérer le romancier liégeois comme un chroniqueur attentif de l’avant Mai 68. Et que sa nostalgie ne va pas sans un certain sens de l’histoire…
Parrainé par François Truffaut
Sortant de l’adolescence à reculons, Bernard Gheur, né en 1945, entre en littérature sous les meilleurs auspices : son premier roman, Le testament d’un cancre, qu’il publie en 1970, reçoit les encouragements du cinéaste François Truffaut qui lui propose d’en écrire la préface. « J’ai eu l’idée de ce premier livre très jeune, à vingt ans. J’ai d’abord écrit quelques pages où la fin se trouvait déjà. À l’époque, ma grande idole était François Truffaut. C’était mon maître à penser. Je lui ai donc envoyé ce petit texte et, à ma grande surprise, il m’a répondu tout de suite. Il me disait avoir apprécié ce texte et me conseillait de développer les différents thèmes pour en faire un roman et il ajoutait : « Je crois sincèrement que vous en êtes capable.” Le fait que cet artiste, qui reste encore aujourd’hui celui que j’admire le plus au monde, me dise que j’en étais capable m’a donné des ailes, une confiance en moi formidable. » S’il a correspondu assez longtemps avec lui, Bernard Gheur n’a jamais rencontré personnellement le cinéaste : « Nous sommes devenus des amis épistolaires, mais nous ne nous sommes jamais rencontrés. Étant journaliste, je lui ai proposé un jour de l’interviewer, un peu comme alibi, mais il n’était pas dans une période de promotion de l’un de ses films et il ne donnait pas d’interviews. C’était un homme très organisé. Il a décliné. Avec le recul, je pense qu’une rencontre aurait été forcément décevante, parce que Truffaut était très réservé, timide, mystérieux, et il préférait écrire que parler. Moi de même, ce qui fait que notre conversation aurait été entrecoupée de longs silences. C’était donc beaucoup plus facile pour moi de correspondre avec lui par lettre. Je n’ai donc aucun regret de ne pas l’avoir rencontré personnellement, car, en s’écrivant, on se rencontrait. » Un peu comme Les quatre cents coups, Le testament d’un cancre raconte l’histoire d’un adolescent révolté, mal dans sa peau : « Le testament d’un cancre est le plus sombre de tous mes livres. Je racontais une dizaine de jours de la vie d’un adolescent, en plein hiver. Un adolescent qui ne voit pas d’issue, qui prend les choses trop au sérieux, qui est trop absolu, donc ça ne peut que finir mal, parce qu’il en demande trop à la vie. Tandis que mes autres livres s’étalent sur un grand nombre d’années. C’est beaucoup plus vaste : je parle de l’adolescence, de l’âge adulte, et le ton est plus léger. »
L’entrée dans la vie adulte
En 1970, Bernard Gheur a vingt-quatre ans. Il a terminé une licence de journalisme, il a fait son service militaire, il a publié son premier roman. Après ce démarrage en fanfare, il prend le temps d’entrer dans la vie : « Après mon service militaire, j’ai commencé à travailler comme journaliste indépendant et, en 1972, je suis entré au journal La Meuse, dans l’équipe des informations générales. Pendant très longtemps j’ai fait le travail de desk : sélection et réécriture des dépêches, titrage, mise en page. C’était un travail de l’ombre qui a son importance, mais qui ne permet guère au journaliste qui en est chargé d’écrire lui-même et de signer des articles. Le travail de journaliste que je faisais me plaisait, je m’adressais à un grand nombre de lecteurs, mais c’était un travail méconnu et éphémère, qui ne dure que vingt-quatre heures. Il fallait tout reprendre jour après jour. Dans ce contexte, j’avais envie de faire quelque chose de plus durable : des romans. Cependant, il m’a fallu pas loin de dix ans pour terminer mon second roman, La scène du baiser. D’une part, il est nécessaire de recharger ses batteries avant d’entamer le deuxième roman et de l’autre, je n’ai pas perdu mon temps : j’ai investi dans mon métier, mes deux fils sont nés. » Parmi les romans suivants, La scène du baiser, La bande originale, on voit émerger, dès le titre, un autre thème de prédilection du romancier liégeois : la passion du cinéma. « C’est une caractéristique de ma génération. Durant notre enfance, c’était le règne des grands cinémas, des grandes salles, comme le Forum ou le Palace où l’on projetait les grands films d’aventure du cinéma américain : les westerns, les films de cape et d’épée, les péplums, etc. Ces films ont fait rêver ma génération. La télévision n’existait pas et le cinéma était pour nous la seule manière de voir des images animées. Quand on allait au cinéma le jeudi après-midi, c’était un moment de magie absolue dont on sortait transformé en cow-boy, en indien, en chevalier. On avait la tête remplie de rêves pour une semaine et ces films nourrissaient nos jeux. Je ne suis pas sûr que le cinéma joue encore un rôle pareil aujourd’hui où les enfants sont devant la TV depuis leur plus jeune âge. Par après, durant les années soixante, ce fut la Nouvelle Vague, avec Lola de Jacques Demy, À bout de souffle, Les quatre cents coups, etc. Ces films correspondaient parfaitement bien à notre âge, parce qu’ils étaient très adolescents. Ces cinéastes parlaient d’eux-mêmes, de leurs propres souvenirs, ils se mettaient en scène, un peu comme s’ils écrivaient un roman. À cette époque, avec quelques copains, nous sommes devenus des fans de la Nouvelle vague. On imitait Jean-Luc Godard, on portait des lunettes fumées. Comme lui, on se mettait à fumer des cigarettes Boyard, de “gros module”, comme on disait à l’époque. Et comme on savait qu’ils tournaient dans la rue, on s’est mis à tourner de petits films dans les rues de Liège, avec une caméra de 8 mm. Le cinéma était aussi un moyen pour approcher les filles : on allait à la sortie des lycées et on proposait aux plus jolies de tourner dans nos films. Elles étaient toujours d’accord. »
Une jeunesse qui s’attarde dans l’adolescence
La bande originale (1996) est une sorte de roman de formation : à la fois, il décrit merveilleusement cette période insouciante et enchantée de l’adolescence du début des années soixante, en plein boom économique des Trente Glorieuses et il trace le portrait d’un jeune homme qui se dirige en tâtonnant vers l’âge adulte, qui se forme à la vie et pas seulement en passant par l’école : « Mon roman précédent,Le lieutenant souriant, évoquait la fin de l’enfance, une période que j’ai préférée à l’adolescence, beaucoup plus sereine. Ici, c’est la fin de l’adolescence : les personnages ont dix-huit ans, ils entrent à l’université, ils sont assez rêveurs, ils ne travaillent pas beaucoup. Ils traînaillent un peu dans l’adolescence, ils ne sont pas pressés d’entrer dans le monde adulte, la réalité. Ils se forment, mais cela ne va jamais sans douleur. Comme dans tous mes romans, l’amitié est très importante. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a dans tous mes livres un duo d’amis, toujours à peu près le même : l’un est plus timide et plus fragile, l’autre est plus fort ; l’un a peur des filles, l’autre a du succès auprès d’elles. » Après cette série de romans centrés sur la jeunesse, le dernier ouvrage de Bernard Gheur, Les étoiles de l’aube, qui paraît en cette rentrée, inaugure une démarche un peu différente. D’abord, parce que le livre est plus long que d’habitude, avec une intrigue complexe, et qu’il est centré sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pas seulement à travers les souvenirs de l’auteur, mais aussi par l’intermédiaire de ceux de nombreux témoignages.
Retour à la fin de la guerre
« La fin de la guerre, c’est la période qui précède ma venue au monde. Je suis né en 1945, dans une période très agitée. Liège était bombardée par les V1 et les V2. Je me dis toujours que, dans les semaines qui ont précédé ma naissance, ma maman, qui m’attendait, devait se précipiter dans les caves plusieurs fois par jour et qu’elle devait être très stressée. Je me demande toujours si le fait que je suis un peu anxieux de nature n’est pas lié à ce stress. » La genèse du livre est intéressante, dans la mesure où elle associe étroitement deux des passions de Bernard Gheur : le journalisme et l’écriture romanesque. « À l’occasion du 60e anniversaire de la Libération, j’avais lancé en 2004 un appel aux lecteurs de La Meuse, en leur proposant de raconter leurs souvenirs. Cet appel avait eu un grand succès. Un nombre impressionnant de gens étaient très contents de raconter toutes sortes d’anecdotes liées à leur expérience ou à celle de leurs parents : le retour d’Allemagne des prisonniers, la rencontre du premier soldat américain. Ils étaient très contents parce qu’ils ont eu une enfance particulièrement romanesque. J’étais frappé, parce qu’on aurait dit chaque fois quelque chose d’inventé, comme dans un roman et pourtant, c’était vrai. Tous ces récits, ces anecdotes, ces situations bizarres, soit comiques, soit douloureuses, cela a fini par constituer le tissu de mon futur roman. Dans ce livre, qui est plein de péripéties, tout est vrai, d’une certaine manière, rien n’est totalement inventé. » Le roman commence par une description de la vie quotidienne de la famille du narrateur, à Liège pendant les bombardements des robots, et se poursuit par l’évocation de la liesse de la Libération. À côté de cet ancrage historique, Les étoiles de l’aube aborde un thème qui, s’il est courant dans le roman ou le cinéma américain, l’est beaucoup moins dans le roman européen : le journalisme, le travail quotidien des salles de rédaction. « C’est un milieu que je connais très bien, mais dont j’ai pu suivre l’évolution. Comme tout va très vite à notre époque, j’ai pu connaître un monde qui n’existe plus aujourd’hui. La presse quotidienne avec les énormes linotypes, les typos, le plomb, l’odeur de l’encre. À l’époque, il régnait dans les ateliers une ambiance incroyable, à la fois électrique, chaleureuse et joyeuse. J’ai connu l’ambiance des salles de rédaction, avec les machines à écrire qui faisaient beaucoup de bruit, des salles perpétuellement enfumées parce que tout le monde fumait, l’excitation du bouclage… Mais tout cela a disparu, à la suite de la révolution de l’informatique et, comme j’ai eu la chance d’avoir connu cette époque, je l’ai introduite dans mon livre. »
Édition et amitié
Ce beau roman, qui nous entraîne de manière de plus en plus haletante sur les traces d’un improbable couple d’enquêteurs, une jeune femme et un vieux journaliste, a posé quelques problèmes de construction à son auteur : « J’ai écrit les deux tiers en 2008, assez facilement. Puis j’ai eu ce blocage à propos de la suite jusqu’au printemps de cette année. Et là, la fin est venue très vite. Cependant, entre 2008 et 2011, j’y ai pensé sans arrêt, mais je n’ai pas fait divers essais. Je cherchais l’issue et quand je l’ai eu trouvée, tout a été très vite. Et là, je dois beaucoup à mes amis éditeurs de la nouvelle collection qui publie mon roman, car ils m’ont fixé une date limite impérative. Il y a eu une pression un peu comparable à celle de la presse : en février, ils m’ont dit qu’il fallait remettre le manuscrit le 31 mars. Mais, j’aime assez cela… » Car, finalement, Les étoiles de l’aube, qui paraît dans la toute nouvelle collection « Plumes du coq », est aussi une affaire d’amitié : « J’ai deux grands amis, Alain Bertrand et Christian Libens, qui savaient que j’étais en train d’écrire un roman sur un aviateur américain. Ensuite, l’éditeur Weyrich leur ayant demandé de réfléchir à la création d’une collection wallonne de romans, ils m’ont proposé de le prendre d’office, à condition que je le termine dans les temps. Cela m’a réjoui, d’abord parce qu’il s’agissait d’amis fidèles, mais aussi parce de la sorte le livre n’aura jamais été refusé nulle part, ce qui constitue une grande satisfaction pour un écrivain. Ils avaient confiance en moi et j’avais confiance en eux. C’est une histoire d’amitié. Il y a sans doute des éditeurs bien plus importants, mais à mon sens l’amitié est primordiale. »
René Begon pour Le Carnet et les Instants.
« Les orphelins de François» de Bernard Gheur est disponible en librairie et sur notre e-shop :